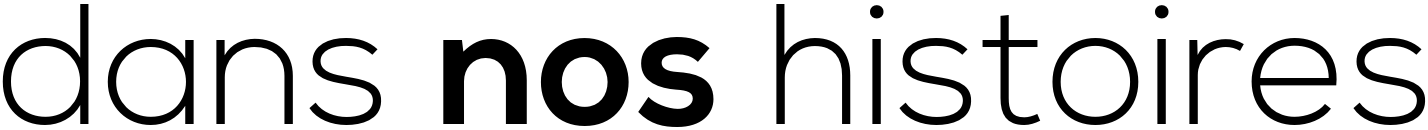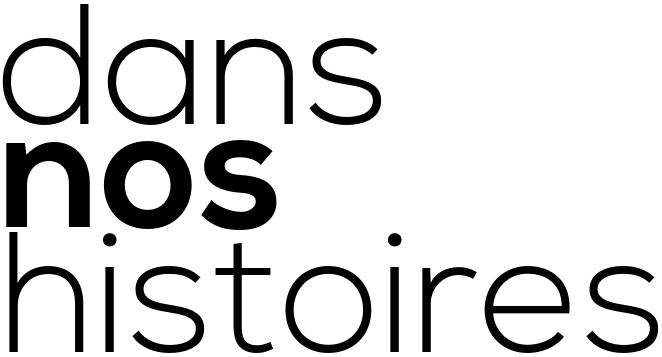à l’écoute des souvenirs
Sigmund Freud
Le livre est proposé ici au format lyber (accès libre intégral). Vous pouvez commander la version papier en cliquant ici.
À l’écoute des souvenirs est la traduction, dans sa version originale, d’un article paru initialement en 1896 dans la Wiener Klinische Rundschau sous le titre « Zur Ätiologie der Hysterie » (vol. 10, n° 22 à 26).
Traduction, préface et notes de Clément Bastien et Anaïs Cretin.
préface
On aura peut-être du mal à reconnaître ce Freud-là, qui ne nous parle ni d’Œdipe ni de sexualité infantile mais d’agressions et de traumatismes, qui ne nous parle pas de fantasmes mais de souvenirs. Le texte qui suit, issu d’une conférence sur ce qu’on appelle alors « l’hystérie », est antérieur de quelques années aux notions qui feront sa renommée. Il donne à entendre un autre Freud, bientôt délaissé pour le vacarme du fantasme œdipien.
Devant une assemblée de médecins médusés, Freud renonce à la sécurité de l’exposé académique pour mieux déployer sa puissance de conviction. Touche par touche, il prépare son auditoire, ménage ses effets, anticipe et désamorce les objections, comme le détective d’un roman policier qui, parvenu au terme de son enquête, a réuni l’ensemble des suspects et s’apprête à dévoiler l’identité de l’assassin. Car plus encore que le patient, l’auditeur (ou le lecteur) est le personnage principal du drame orchestré par Freud : c’est lui qui s’agite dans les méandres de l’argumentation, et que Freud mène de déconvenues en découvertes (et par le bout du nez) jusqu’à sa conclusion implacable.
D’ailleurs, comme dans les romans policiers, le coupable était sous nos yeux depuis le début, mais il était au-dessus de tout soupçon. On cherchait la source de l’hystérie dans la fabulation ou dans l’hérédité, elle provient en réalité, assène Freud, d’une effraction brutale dans le monde de l’enfance, d’une « expérience sexuelle prématurée », souvent à caractère incestueux, dont la mémoire reste agissante bien des années après, produisant les symptômes spectaculaires qui fascinent tant son époque. Aussi minutieusement établie soit-elle, la thèse est inaudible et sera très mal reçue.
On reconnaîtra sans peine dans les propos de Freud l’assurance du bourgeois, teintée de mépris pour les classes populaires, et plus encore le pouvoir objectivant du médecin, à la recherche d’une méthode « moins dépendante de ce que nous dit le malade ». Mais quoi qu’il en dise, Freud a écouté ses patients, et les a entendus : contre la suspicion de mensonge, d’invention ou de complaisance qui pèse toujours sur la parole hystérique, il soutient ses mots, relaie la mémoire qu’elle porte, et témoigne avec détermination de sa vérité.
Plus, en montrant que « la réaction des hystériques n’est exagérée qu’en apparence », qu’elle n’est si vive que parce qu’elle renvoie au traumatisme qu’elle continue d’exprimer, Freud peut réinscrire le comportement hystérique dans une normalité psychique. L’hystérique n’est plus le phénomène étrange qu’on exhibe pour la curiosité médicale, comme dans les présentations publiques de Charcot, ni même d’abord une personne malade, mais un être qui a été violenté, et que cette violence a constitué durablement. On ne saurait mieux dire sa dignité.
Toutes ces propositions dessinent avec Freud une psychanalyse en prise directe avec la violence du monde social – si proche de nos histoires.
1ère partie
Messieurs, quand on veut comprendre ce qui cause un état pathologique comme l’hystérie [1], on procède d’abord à une recherche par anamnèse : on interroge le malade [2] ou ses proches pour savoir à quelles influences néfastes ils attribuent ces symptômes névrotiques. Bien sûr, ce qu’on apprend de cette façon est faussé par tout ce qui entretient le malade dans l’ignorance de son propre état : sa compréhension limitée des facteurs pathologiques, ses raisonnements abusifs (« à la suite de, donc à cause de »), sa réticence à se rappeler certains maux et certains traumatismes, ou à en parler. C’est pourquoi, dans une recherche de ce genre, on refuse fermement de souscrire aux croyances des patients sans examen critique poussé ou de les laisser décider pour nous des causes de leur névrose. On admet bien certaines de leurs affirmations récurrentes, par exemple que l’état hystérique est le contrecoup durable d’une émotion. Mais on y ajoute un facteur que le malade ne formule jamais de lui-même et qu’il ne nous accorde qu’à contrecœur : une prédisposition héréditaire qui lui vient de ses parents. Vous savez que, d’après l’influente école de Charcot [3], l’hérédité seule mérite vraiment le statut de cause de l’hystérie, toute autre nuisance, quelles que soient sa nature ou son intensité, n’intervenant qu’à titre d’occasion, d’« agent provocateur ».
Vous me l’accorderez, on aimerait découvrir un autre chemin, qui soit à coup sûr moins dépendant de ce que nous dit le malade. Le dermatologue, par exemple, sait reconnaître un chancre syphilitique à son rebord, sa texture et sa forme, sans être induit en erreur par les protestations du patient, qui dément l’existence d’une source d’infection [4]. Le médecin légiste, pour élucider l’origine d’une blessure, se passe des indications du blessé. Eh bien, pour l’hystérie aussi, on peut accéder à la connaissance des causes à partir des symptômes. Mais pour vous expliquer le rapport entre les deux méthodes, je voudrais faire appel aux progrès réalisés dans un autre domaine.
Imaginez qu’un explorateur arrive dans une région peu connue, où des ruines piquent sa curiosité : des décombres de murs, des débris de colonnes, des tablettes aux écritures estompées et illisibles. Il peut se contenter d’observer ce qu’il voit, puis questionner les habitants du coin (peut-être à moitié barbares) sur ce que la tradition leur enseigne de l’histoire et du sens de ces vestiges, noter ce qu’on lui raconte – et reprendre sa route. Mais il peut aussi s’y prendre autrement. Il peut avoir pris avec lui des pioches, des pelles et des bêches, et enrôler les habitants. Avec eux, il peut s’attaquer aux ruines, déblayer les gravats et, en partant de ce qui est visible, mettre au jour ce qui est enterré. En cas de succès, les découvertes s’expliquent d’elles-mêmes : les murs font partie des fortifications d’un palais ou d’un trésor, les colonnes en ruine forment un temple, et les nombreuses inscriptions, bilingues peut-être, révèlent un alphabet et une langue. Une fois déchiffrées et traduites, elles nous livrent des informations inattendues sur les événements ancestraux que commémorent ces monuments. Les pierres parlent !
Si, d’une façon qui s’en rapproche un peu, on veut donner de la voix aux symptômes d’une hystérie pour qu’ils témoignent de ses origines, il faut partir de cette découverte capitale de Josef Breuer [5] : les symptômes de l’hystérie (stigmates mis à part [6]) sont déterminés par certaines expériences vécues du malade, des expériences traumatisantes qui sont reproduites dans sa vie psychique sous la forme de souvenirs. Ce qu’on doit faire, c’est utiliser son procédé (ou un autre du même ordre) pour ramener l’attention du malade de son symptôme à la scène dans et par laquelle ce symptôme est né. Alors, quand il reproduit la scène traumatique qu’il a identifiée, on supprime le symptôme en imposant une correction après-coup au cours psychique initial.
Je ne veux pas parler aujourd’hui de la technique complexe de ce procédé thérapeutique ou des avancées qu’il a rendues possibles en psychologie. Mais c’est de là que je devais partir, parce que les analyses conduites sur ces principes semblent également nous mettre sur la voie des causes de l’hystérie. En soumettant à une telle analyse davantage de symptômes chez un grand nombre de gens, on connaîtra bientôt autant de scènes traumatisantes. Or, c’est dans ces expériences que se sont manifestées les causes de l’hystérie : on peut donc espérer apprendre de leur étude quelles influences produisent les symptômes hystériques, et de quelle manière.
Nos vœux seront exaucés, car les thèses de Breuer sont confirmées quand on multiplie les cas. Mais le chemin qui mène des symptômes de l’hystérie à ses causes est plus long que prévu et prend un tour inattendu.
Car, soyons clairs, rapporter un symptôme hystérique à une scène traumatique ne nous avance que si cette scène satisfait deux conditions : si elle a pu déterminer le symptôme en question, et si on lui reconnaît la force traumatique nécessaire. Mais un exemple vaut toutes les explications ! Soit le symptôme du vomissement hystérique : on estimera son origine établie (jusqu’à un certain point) si l’analyse le rapporte à une expérience qui a provoqué à juste titre un grand dégoût, comme la vue d’un corps en putréfaction. Mais que le vomissement provienne en fait d’une grande frayeur, lors d’un accident de train par exemple, et nous voilà insatisfaits. On devra en effet se demander comment la peur a conduit tout droit au vomissement, qu’elle n’a pourtant pas pu déterminer. L’explication est tout aussi lacunaire si le vomissement provient, disons, de la consommation d’un fruit un peu pourri. Cette fois, il est bien déterminé par le dégoût, certes, mais on ne comprend pas comment ce dégoût a pu devenir si puissant qu’il persiste dans un symptôme hystérique : il manque à cette expérience la force traumatique nécessaire.
Dans quelle mesure les scènes traumatiques mises au jour par l’analyse remplissent-elles nos deux conditions pour d’autres symptômes et d’autres cas ? C’est la première grande déception ! Certes, quelques fois, la scène traumatique d’où procède le symptôme possède effectivement et l’effet déterminant et la force traumatique indispensables pour le comprendre. Mais bien plus souvent, incomparablement plus souvent, on a affaire à l’une des trois possibilités restantes, qui nous sont si défavorables : soit la scène à laquelle nous conduit l’analyse, et dans laquelle le symptôme est apparu pour la première fois, nous semble incapable de le provoquer, car son contenu n’a aucun rapport avec la nature du symptôme ; soit elle a bien un rapport avec le symptôme, mais elle est normalement inoffensive et aurait dû rester sans effet ; soit, enfin, elle nous déconcerte d’un côté comme de l’autre, à la fois inoffensive et étrangère aux spécificités du symptôme hystérique.
(Je remarque en passant que la conception de Breuer sur l’origine des symptômes hystériques n’est pas ébranlée par la découverte de scènes traumatiques qui relèvent d’expériences en elles-mêmes insignifiantes. Breuer – suivant Charcot – admet en effet que même une expérience inoffensive peut faire traumatisme et déployer une force déterminante, pour peu qu’elle trouve la personne dans un état psychique particulier, dit hypnoïde [7]. Mais je trouve pour ma part qu’il n’y a souvent aucune raison de supposer de tels états hypnoïdes. Surtout, cette hypothèse ne nous aide pas à résoudre les autres difficultés, en particulier le fait que les scènes traumatiques soient si souvent dépourvues de l’effet déterminant approprié.)
Ajoutez à cela, Messieurs, qu’une autre déception talonne la première, particulièrement douloureuse pour nous autres médecins. Non seulement des correspondances comme celles-là nous laissent sur notre faim, mais elles n’ont pas non plus d’effet thérapeutique : les symptômes du malade restent entiers. Vous comprendrez à quel point la tentation est grande alors de renoncer à poursuivre un travail par ailleurs très pénible.
Mais peut-être suffirait-il d’une nouvelle idée pour nous tirer d’affaire, et pour nous conduire à des résultats valables ! Cette idée, la voici. On sait par Breuer qu’on peut résoudre les symptômes hystériques en trouvant le chemin qui mène de ces symptômes au souvenir d’une expérience traumatique. Mais si le souvenir en question ne répond pas à nos attentes, peut-être faut-il faire un pas de plus ? Peut-être que, derrière la première scène traumatique, se cache le souvenir d’une autre scène, plus appropriée et plus efficace sur le plan thérapeutique, de sorte que la première scène apparaît finalement comme un simple maillon dans une chaîne d’associations. Et peut-être que des scènes inopérantes continuent d’apparaître – comme autant de transitions nécessaires – jusqu’à ce que, partis du symptôme hystérique, on arrive finalement à la scène réellement traumatisante, satisfaisante à tous points de vue, thérapeutique aussi bien qu’analytique.
Eh bien, Messieurs, cette hypothèse est la bonne. Quand la première scène ne convient pas, on dit au malade que cette expérience n’explique rien, mais que derrière elle, il doit s’en cacher une autre, plus ancienne et plus importante. Puis, avec la même technique, on dirige son attention sur le fil associatif qui relie les deux souvenirs, celui qu’on a déjà trouvé et celui qui reste à découvrir [8]. La suite de l’analyse conduit alors immanquablement à de nouvelles scènes, qui présentent les caractéristiques attendues. Reprenons par exemple le cas de vomissement hystérique dont je parlais plus tôt, qu’on avait rapporté à la frayeur du malade lors d’un accident de train. En poursuivant l’analyse, j’apprends que cet accident a réveillé le souvenir d’un autre accident, plus ancien, dont il avait été témoin, et que la vue d’un cadavre l’avait alors empli d’horreur et de dégoût. C’est comme si l’effet conjugué des deux scènes permettait de satisfaire nos conditions : la première, avec la frayeur, apporte la force traumatique nécessaire, et l’autre, par son contenu, fournit l’effet déterminant. Dans l’autre cas, où le vomissement était rapporté à la consommation d’une pomme un peu pourrie, le complément se fait à peu près comme ceci : la pomme pourrie a rappelé au malade une expérience plus ancienne, quand, ramassant des pommes dans un jardin, il était tombé par hasard sur un répugnant cadavre d’animal.
Je ne reviendrai plus sur ces exemples : je dois reconnaître qu’ils ne viennent pas de ma pratique mais que je les ai inventés. D’ailleurs, ce sont très probablement de mauvaises inventions ! Je tiens même qu’il est impossible de résoudre de la sorte un quelconque symptôme hystérique. Mais j’ai dû me servir d’exemples fictifs pour plusieurs raisons, et je peux vous en donner une tout de suite : les vrais exemples sont tous incomparablement plus complexes ; vous parler en détail d’un seul cas occuperait tout le temps qui m’est imparti. La chaîne associative a toujours plus de deux maillons, et les scènes traumatiques ne forment pas de simples rangées, comme dans un collier de perles, mais des systèmes ramifiés, comme dans un arbre généalogique, où pour chaque nouvelle expérience, deux autres au moins entrent en jeu sous forme de souvenirs. Bref, rendre compte de la façon dont un seul symptôme est résolu demanderait en fait de présenter dans son intégralité l’histoire de la maladie.
Mais je ne veux pas manquer de souligner tout de suite, avec force, une conclusion inattendue du travail analytique le long de ces chaînes de souvenirs : aucun symptôme hystérique ne peut provenir seulement d’une expérience donnée ; à chaque fois, le souvenir d’expériences antérieures, éveillé par association, y concourt. Si cette proposition, comme je le pense, est vraie sans exception, elle nous montre aussi sur quel fondement bâtir une théorie psychologique de l’hystérie.
Vous vous dites peut-être que les rares cas où l’analyse rapporte directement le symptôme à une scène traumatique appropriée, et le supprime du même coup (comme le raconte Breuer à propos d’Anna O. [9]) – que ces cas, donc, constituent quand même de puissantes objections à la portée générale de la thèse que je viens d’énoncer. Et en effet, cela en a tout l’air ! Mais je peux vous l’assurer, j’ai toutes les raisons de penser qu’ici aussi, il y a une chaîne de souvenirs actifs qui remonte bien avant la première scène traumatique, quand bien même il peut suffire de la reproduire pour supprimer le symptôme.
Que les symptômes hystériques ne puissent se former qu’avec le concours de souvenirs, c’est tout de même étonnant, d’autant que ces souvenirs, d’après tout ce que nous disent les malades, ne leur sont pas venus à l’esprit au moment où le symptôme est apparu pour la première fois. Assurément, il y a là matière à réflexion. Mais pour l’instant, ces problèmes ne doivent pas nous détourner du chemin qui mène aux causes de l’hystérie. Il faut plutôt se demander : qu’y a-t-il au bout des chaînes de souvenirs associés que l’analyse nous révèle ? Jusqu’où vont-elles ? Ont-elles quelque part une fin naturelle ? Peuvent-elles nous mener à des expériences qui, d’une façon ou d’une autre, soient toutes apparentées, par leur contenu ou par la période de la vie concernée, de sorte qu’on puisse y voir les causes de l’hystérie ?
Mon expérience me permet d’ores et déjà de répondre à ces questions. En analysant un cas à partir de chacun de ses symptômes, on arrive à une série d’expériences dont les souvenirs sont reliés entre eux par association. Les chaînes de souvenirs remontent d’abord séparément les unes des autres. Mais comme je l’ai dit, elles se ramifient : à partir d’une scène unique, on atteint deux souvenirs à la fois ou plus, et de ces souvenirs partent alors des chaînes secondaires, dont les maillons peuvent à leur tour être associés à des maillons de la chaîne principale. La comparaison avec l’arbre généalogique d’une famille – une famille dont les membres se seraient mariés entre eux – n’est décidément pas mauvaise du tout. D’autres complications viennent encore de ce qu’une même scène peut être sollicitée plusieurs fois dans la même chaîne, de sorte qu’elle entretient des relations multiples avec une scène ultérieure, directes et indirectes. Bref, tout cela est loin d’être simple, et le fait de découvrir les scènes dans un ordre inverse (ce qui justifie la comparaison avec la fouille des strates successives d’une ruine) n’aide pas non plus à comprendre ce qui s’est passé.
Que l’on pousse l’analyse plus loin, et de nouvelles complications apparaissent. Les chaînes associatives relatives à chaque symptôme commencent à interagir : les arbres généalogiques s’entrecroisent. Une expérience donnée dans la chaîne de souvenirs du vomissement (par exemple) réveille, en plus des maillons antérieurs de cette chaîne, un souvenir d’une autre chaîne, responsable d’un autre symptôme – disons, un mal de tête. Cette expérience appartient donc aux deux séries à la fois : elle constitue un nœud, comme il s’en trouve plusieurs dans chaque analyse. Sur le plan clinique, il s’ensuit peut-être qu’au bout d’un certain temps, les deux symptômes apparaissent en même temps, en symbiose, alors qu’en eux-mêmes ils sont indépendants l’un de l’autre. En remontant encore plus loin en arrière, on trouve des nœuds d’une autre sorte : c’est là que les chaînes associatives convergent, c’est là que se trouvent des expériences d’où procèdent deux symptômes ou plus, chaque chaîne se liant à un détail différent.
Mais voici le résultat le plus important de cette analyse systématique : quel que soit le cas, et quel que soit le symptôme dont on part, on en arrive toujours au domaine de la vie sexuelle. Aurait-on découvert cette fois une condition de formation des symptômes hystériques ?
D’expérience – je vous vois venir – c’est précisément cette affirmation, ou sa portée générale, que vous allez contester. Je devrais peut-être dire : c’est ce que vous aurez envie de contester. Car aucun d’entre vous, j’en suis sûr, ne dispose encore de recherches qui, avec le même procédé, aient donné un résultat différent. Sur l’objet même du débat, je veux seulement remarquer la chose suivante : cette primauté du facteur sexuel, je ne l’ai pas choisie. Charcot et Breuer, les deux chercheurs auprès de qui j’ai commencé mes travaux sur l’hystérie, étaient loin d’y souscrire, y répugnaient même, et c’était aussi mon cas au début. Seules les recherches les plus minutieuses et les plus ingrates m’ont converti à l’idée que je m’en fais aujourd’hui – et encore, très lentement.
Soumettez ce que je dis au plus strict examen : voici que, dans quelques dix-huit cas d’hystérie, j’ai pu déceler ce lien pour chacun des symptômes, confirmé par le succès de la thérapie quand les circonstances le permettaient. Bien sûr, vous pouvez me dire que la dix-neuvième et la vingtième analyse montreront peut-être que les symptômes hystériques ont encore d’autres sources, réduisant ainsi la validité de l’explication sexuelle à 80% des cas. Eh bien, attendez de voir si vous voulez, mais puisque ces dix-huit cas sont aussi tous ceux que j’ai analysés, et puisque personne ne les a choisis pour me faire plaisir, vous comprendrez que moi, je n’y croie pas, et que je sois prêt au contraire à m’avancer au-delà des preuves. Du reste, il y a encore une autre raison qui me pousse en ce sens, mais qui n’a pour l’instant qu’une valeur subjective : la seule tentative d’explication du mécanisme physiologique et psychique de l’hystérie qui m’a permis de relier entre elles toutes mes observations requiert absolument l’intervention des forces sexuelles.
Ainsi donc, quand les chaînes de souvenirs convergent, on finit par tomber sur le domaine de la sexualité, et sur un petit nombre d’expériences qui se produisent pour la plupart au même moment, pendant la puberté. De ces expériences, il nous faut tirer les causes de l’hystérie, et comprendre la formation des symptômes hystériques. Mais encore une fois, quelle déception ! Ces expériences qu’on s’est donné tant de mal à trouver, qu’on a extraites de toute la masse de souvenirs, et qui nous semblent être les expériences traumatiques les plus anciennes, ont bien en commun d’être sexuelles et de se produire à la puberté. Mais elles sont par ailleurs si différentes, et tellement inégales ! Dans certains cas, il s’agit assurément de graves traumatismes : quand une jeune fille subit une tentative de viol et découvre d’un coup toute la brutalité du désir sexuel, ou quand un enfant est le témoin involontaire des ébats sexuels de ses parents, qui révèlent une laideur insoupçonnée en même temps qu’ils offensent les sentiments enfantins et le sens moral, etc. Mais dans d’autres cas, elles sont curieusement anecdotiques, comme chez cette patiente : un garçon de ses amis lui avait caressé tendrement la main et, une autre fois, lui avait fait du pied sous la table, avec l’air de quelqu’un qui est en train de faire quelque chose d’interdit. Chez une autre jeune femme, le simple fait d’entendre une devinette qui suggérait une réponse obscène avait suffi à susciter la première crise d’angoisse, inaugurant ainsi la maladie.
À l’évidence, des résultats comme ceux-là ne nous aident pas à comprendre ce qui provoque les symptômes hystériques. S’il faut admettre comme traumatismes ultimes de l’hystérie des événements graves aussi bien qu’insignifiants, des expériences du corps aussi bien que des impressions visuelles ou des choses entendues, autant dire que les hystériques sont des êtres atypiques (vraisemblablement en raison d’une prédisposition héréditaire ou d’une dégénérescence) chez qui la crainte de la sexualité, qui a son rôle à la puberté, atteint un niveau pathologique et se fixe durablement ; qu’ils sont en quelque sorte psychiquement incapables de soutenir les exigences de la sexualité. Mais cette conception néglige l’hystérie chez les hommes. Et même sans objection aussi grossière, la tentation d’en rester là ne serait pas bien grande : on ne sent que trop tout ce que cette explication a de partiel, de confus, d’insuffisant.
Heureusement pour nous, quelques-unes des expériences sexuelles de la puberté présentent un défaut supplémentaire, bien fait pour nous inciter à poursuivre le travail analytique. Il arrive en effet qu’elles soient elles aussi dépourvues de l’effet déterminant approprié – même si c’est beaucoup plus rare que pour les scènes traumatiques plus tardives. Ainsi et par exemple, suite aux expériences pourtant inoffensives de leur puberté, les deux patientes dont je viens de parler avaient développé des douleurs singulières dans les zones génitales, qui étaient devenues les principaux symptômes de la névrose. Mais ces douleurs ne venaient ni des scènes de la puberté, ni de scènes plus tardives, et il ne s’agissait pas non plus, en tout état de cause, de sensations organiques normales ou de signes d’excitation sexuelle. On n’est pas loin de se dire que ce qui détermine ces symptômes, il faut le chercher dans d’autres expériences, plus anciennes encore ! Et qu’il faudrait ici, pour la seconde fois, suivre l’idée salutaire qui nous avait conduits tout à l’heure des premières scènes traumatiques aux chaînes de souvenirs qui se trouvaient derrière elles.
Ce faisant, on est rendu aux débuts de l’enfance, une période qui précède le développement de la vie sexuelle : faut-il dès lors renoncer à une explication sexuelle de l’hystérie ? On est pourtant en droit de penser que de sourdes excitations sexuelles existent aussi dans l’enfance, et que le développement ultérieur de la sexualité est peut-être influencé de façon décisive par des expériences de l’enfance. Les dommages affectant un organe qui n’est pas encore formé ou une fonction en cours de développement ont en effet, et si souvent, des conséquences plus graves et plus durables qu’à un âge plus avancé. Il est possible que les réactions anormales aux impressions sexuelles, qui nous surprennent chez les hystériques au moment de la puberté, reposent de façon tout à fait générale sur des expériences sexuelles de ce genre durant l’enfance – qui, dans ce cas, doivent êtres similaires entre elles et suffisamment graves. S’il en est ainsi, s’ouvre alors une nouvelle perspective : ce qu’on abandonnait jusque-là à une mystérieuse prédisposition héréditaire peut-il s’expliquer par une acquisition précoce ? Et dans la mesure où des expériences infantiles à caractère sexuel ne pourraient exprimer d’effet psychique qu’à travers les traces qu’elles laissent dans la mémoire, n’y aurait-il pas là un heureux complément à ce résultat de l’analyse selon lequel les symptômes hystériques ne naissent jamais qu’avec le concours de souvenirs ?
2e partie
Vous vous doutez bien, Messieurs, que si j’ai poussé aussi loin ce raisonnement, c’est pour vous préparer au fait que c’est le seul qui, après tant de détours, nous conduise au but. C’est là en effet que se termine véritablement notre long et difficile travail analytique, que toutes nos exigences et toutes nos attentes sont enfin satisfaites. Si on pousse l’analyse jusqu’à la prime enfance, aussi loin que le peut la mémoire, on amène invariablement le malade à reproduire des expériences qui, du fait de leurs spécificités et de leurs relations aux symptômes ultérieurs, doivent être considérées comme les causes de la névrose. Ces expériences infantiles ont elles aussi un contenu sexuel, mais elles sont beaucoup plus homogènes que les scènes de la puberté : il ne s’agit plus ici de l’éveil de motifs sexuels par une quelconque impression sensorielle, mais d’expériences sexuelles dans son propre corps, de rapports sexuels (au sens large). Vous m’accorderez que l’importance de telles scènes se passe d’autre justification. Ajoutez encore à cela qu’on peut trouver à chaque fois, dans leur détail, les facteurs déterminants qui manqueraient aux scènes plus tardives, reproduites en premier.
Je pose donc l’affirmation suivante : au fondement de chaque cas d’hystérie se trouvent une ou plusieurs expériences sexuelles prématurées, qui appartiennent à la prime enfance et que le travail analytique permet de reproduire malgré les décennies qui nous en séparent. Je tiens qu’il s’agit là d’une découverte importante, d’une « source du Nil » pour la neuropathologie [10], mais je ne sais pas bien comment poursuivre mon propos. Dois-je vous exposer les faits tirés de mes analyses ? Ou recevoir d’abord l’avalanche d’objections et de doutes qui, j’en suis sûr, vous assaille à présent ? C’est ce que je choisis ; peut-être sera-t-il possible ensuite de revenir d’autant plus sereinement sur les faits.
a) Quelqu’un d’absolument hostile à une conception psychologique de l’hystérie, qui ne veut pas renoncer à l’espoir qu’on puisse, un jour, rapporter ses symptômes à de « subtiles modifications anatomiques » [11], et qui rejette l’idée que les fondements matériels des modifications hystériques sont nécessairement de même nature que ceux de nos processus psychiques normaux – celui-là n’accordera évidemment aucun crédit aux résultats de nos analyses. La différence de principe entre ses hypothèses et les nôtres nous dispense néanmoins de le convaincre sur des points particuliers.
Mais même en étant moins réticent à l’égard des théories psychologiques de l’hystérie, on voudra tout de même savoir quelles garanties présente la psychanalyse. N’est-il pas tout à fait possible que le médecin impose de prétendus souvenirs au malade complaisant ? Ou qu’il prenne pour argent comptant ce qui n’est qu’invention délibérée ou fantaisie du malade ? Eh bien, je réponds qu’on ne pourra évaluer et dissiper les doutes sur la fiabilité de la psychanalyse en général qu’une fois disponible une présentation complète de sa technique et de ses résultats.
Plus d’un argument, néanmoins, permettent d’ores et déjà de lever les doutes sur l’authenticité des scènes sexuelles infantiles. D’abord, le comportement des malades dément point par point qu’elles puissent être autre chose que des expériences réelles, qui les embarrassent et qu’ils répugnent à se remémorer. Ils ignorent tout de ces scènes avant l’analyse, s’offusquent généralement quand on les avertit qu’elles risquent de refaire surface, et ne peuvent y être amenés que par la contrainte la plus forte du traitement. Lorsqu’ils les rappellent à la conscience, ils sont traversés par les sensations les plus violentes, dont ils ont honte et qu’ils cherchent à dissimuler. Et, alors qu’ils viennent de les revivre de façon si convaincante, ils refusent encore d’y croire car, disent-ils, c’est comme si cela ne leur était pas vraiment arrivé. Voilà bien, semble-t-il, une preuve absolument concluante : pourquoi les malades soutiendraient-ils aussi catégoriquement qu’ils n’y croient pas si – quelle qu’en soit la raison – ils avaient tout inventé ?
Que le médecin impose au malade de tels souvenirs, qu’il lui suggère ces scènes et leur reconstitution, c’est plus difficile à réfuter, mais pour moi tout aussi indéfendable. Je n’ai encore jamais réussi à imposer à un malade une scène que j’attendais de telle façon qu’il semble revivre en même temps toutes les émotions qui vont avec. Peut-être que d’autres y arrivent mieux que moi.
Beaucoup d’autres choses, toutefois, attestent encore de la réalité des scènes sexuelles infantiles. Et d’abord, la constance de certains détails, qui ne peut venir que des conditions requises par ces expériences, sans quoi il nous faudrait croire à quelque entente secrète entre les malades. Mais aussi le fait que les malades présentent parfois comme anodins des événements dont ils ne comprennent visiblement pas la signification – ils en seraient sinon horrifiés – ou qu’ils mentionnent en passant des détails qui, pour être appréciés à leur juste valeur, demandent qu’on soit suffisamment averti des subtilités du réel.
Ce genre de choses renforce l’impression que les malades ont réellement vécu ce qu’ils reproduisent sous la contrainte de l’analyse comme des scènes de leur enfance. Mais la relation entre les scènes infantiles et l’histoire entière de la maladie en fournit une autre preuve, plus solide encore. C’est comme dans les puzzles pour enfants : après toutes sortes d’essais, on finit par savoir avec certitude quelle pièce convient, parce que c’est la seule qui complète l’image et dont les bords s’ajustent aux autres pièces, sans interstices ni chevauchements. De même le contenu des scènes infantiles vient-il indiscutablement compléter le tableau associatif et logique de la névrose, dont l’histoire devient claire – on a souvent envie de dire : évidente.
J’ajoute – mais je ne veux pas le mettre au premier plan – que dans un certain nombre de cas, l’efficacité thérapeutique prouve aussi l’authenticité des scènes infantiles. Il arrive qu’on puisse obtenir une guérison totale ou partielle sans avoir besoin de remonter aussi loin ; ailleurs, on n’arrive à rien avant la fin naturelle de l’analyse, avec la mise au jour des traumatismes les plus anciens. Je crains que dans le premier cas, on ne soit pas à l’abri de récidives, et j’ai bon espoir au contraire qu’une psychanalyse menée à son terme guérisse définitivement de l’hystérie. Mais n’anticipons pas sur les leçons de l’expérience !
Il y aurait encore une autre preuve, celle-là vraiment incontestable, de l’authenticité des expériences sexuelles infantiles : si les déclarations du patient étaient confirmées par quelqu’un d’autre, qu’il soit lui-même en analyse ou non. Il faudrait qu’ils aient pris part dans leur enfance à la même expérience, par exemple en ayant eu des relations sexuelles l’un avec l’autre. De tels rapports entre enfants ne sont pas rares du tout, comme vous le verrez dans un instant : il arrive même assez souvent qu’ils développent tous deux une névrose par la suite. Et pourtant c’est un coup de chance, je crois, d’avoir pu obtenir cette confirmation objective pour deux de mes dix-huit cas. Une fois, le frère d’une patiente, lui-même en bonne santé, a corroboré de son propre chef des scènes de ce genre durant l’enfance (à défaut des expériences les plus précoces), sur fond de rapports sexuels anciens. Une autre fois, le hasard a voulu que deux de mes patientes aient eu, enfants, des rapports sexuels avec le même homme, certaines fois ensemble : elles avaient toutes les deux développé le même symptôme, conséquence de ces expériences infantiles et témoin de leur histoire commune.
b) En dernière analyse, il faut donc voir dans les expériences sexuelles de l’enfance – stimulations des parties génitales, caricatures de rapports sexuels, etc. – les traumatismes dont découlent la réaction hystérique aux expériences de la puberté et la formation de symptômes hystériques. Deux objections, contradictoires entre elles, ne manqueront pas d’être soulevées ici. Certains diront que les abus sexuels sur des enfants ou entre enfants sont trop rares pour qu’on puisse en faire la condition d’une névrose aussi courante que l’hystérie. D’autres au contraire feront peut-être valoir que de telles expériences sont très fréquentes, trop fréquentes pour qu’on puisse leur attribuer une valeur explicative. Plus, ils diront qu’en posant quelques questions, il n’est pas difficile de trouver des gens qui se souviennent de scènes de séduction [12] et d’abus sexuel dans leur enfance mais qui n’ont jamais été hystériques. On nous opposera enfin cet argument de poids : alors même que, tout le montre, l’impératif de protection de l’enfance en matière sexuelle est transgressé dans les classes populaires bien plus souvent que dans les classes supérieures, l’hystérie n’y est assurément pas plus fréquente.
Je commence par le plus facile : il me semble certain que nos enfants sont beaucoup plus souvent victimes d’agressions sexuelles que ne le laisserait penser l’insouciance des parents en la matière. En commençant à chercher ce qu’on savait sur le sujet, des collègues m’ont parlé de plusieurs publications pédiatriques dénonçant les pratiques sexuelles fréquentes des nourrices et des bonnes d’enfants, y compris sur des nourrissons. Et je suis tombé dernièrement sur une étude du docteur Stekel, de Vienne, consacrée au « coït dans l’enfance ». Je n’ai pas eu le temps de recueillir d’autres témoignages, mais même s’il n’y en avait pas beaucoup, une attention accrue au phénomène confirmerait sans doute rapidement la fréquence élevée des expériences sexuelles et de l’activité sexuelle dans l’enfance.
Quoi qu’il en soit, mes résultats d’analyse parlent d’eux-mêmes. Comme je l’ai indiqué, j’ai pu constater des expériences sexuelles infantiles de ce genre dans l’ensemble de mes dix-huit cas – cas d’hystérie pure ou d’hystérie mêlée d’obsessions, pour six hommes et douze femmes. Je peux répartir ces cas en trois groupes, d’après l’origine de la stimulation sexuelle :
- dans le premier groupe, il s’agit d’agressions, d’abus uniques ou, en tout cas, ponctuels, la plupart du temps sur des petites filles, par des adultes qu’elles ne connaissent pas (et qui savent comment éviter d’infliger de graves blessures physiques). Il n’y est pas question du consentement de l’enfant, et c’est la peur qui prédomine ;
- un deuxième groupe est constitué de ces cas, de loin les plus nombreux, où un adulte qui s’occupe de lui (une bonne d’enfants, une nourrice, une gouvernante, un précepteur, ou encore, bien trop souvent, un proche parent) initie l’enfant à la sexualité et entretient avec lui, souvent pendant des années, une relation amoureuse en bonne et due forme (avec son pendant psychique) ;
- pour finir, on trouve dans le troisième groupe les relations entre enfants à proprement parler, les rapports sexuels entre deux enfants de sexe différent, la plupart du temps entre frères et sœurs, qui se poursuivent souvent au-delà de la puberté et qui ont les conséquences les plus durables pour l’un comme pour l’autre.
La plupart des cas combinent tout ou partie de ces possibilités. Quelquefois, l’accumulation d’expériences sexuelles de tous ordres est proprement stupéfiante. Vous comprendrez toutefois aisément cette particularité de mes observations si vous considérez que je me suis exclusivement occupé de névroses graves, menaçant toute faculté d’exister.
Dans les cas de relation entre enfants, j’ai parfois été en mesure de montrer que le garçon (ici encore en position d’agresseur) avait d’abord été séduit par une adulte et que, pressé par sa libido prématurément éveillée et sous la contrainte de ce souvenir, il cherchait ensuite à répéter sur la petite fille cela même qu’on lui avait appris, sans en modifier quoi que ce soit de lui-même. De ce fait, je suis enclin à penser que, sans séduction préalable, les enfants ne peuvent en venir d’eux-mêmes à de tels actes. Ainsi, il y aurait toujours un adulte à l’origine de la névrose, que les enfants se transmettraient ensuite l’un à l’autre. Pensez encore à la fréquence particulière avec laquelle, dans l’enfance, les relations sexuelles se produisent précisément entre frères et sœurs, et entre cousins et cousines, car ils ont souvent l’occasion d’être ensemble. Imaginez alors que, dix ou quinze ans plus tard, plusieurs d’entre eux soient malades : n’y verrait-on pas le signe d’une disposition héréditaire à l’hystérie – là où il n’y a en fait qu’une pseudo-hérédité et, en réalité, une transmission, une infection dans l’enfance ?
Je passe maintenant à l’autre objection, qui nous accorde justement la fréquence des expériences infantiles mais souligne que de nombreuses personnes se souviennent de telles scènes sans être devenues hystériques. Je dirai d’abord que la fréquence excessive d’un facteur de maladie n’est pas un argument contre sa valeur explicative. Le bacille de Koch n’est-il pas partout ? N’y a-t-il pas bien plus de gens qui le respirent que de malades de la tuberculose ? Il a manifestement besoin d’adjuvants pour provoquer la tuberculose, son effet spécifique, mais sa valeur explicative n’en est pas diminuée pour autant : pour estimer que le bacille est la cause spécifique de la tuberculose, il suffit qu’elle ne soit pas possible sans lui. Et c’est la même chose ici ! Que de nombreuses personnes vivent des scènes sexuelles dans l’enfance sans devenir hystériques n’est pas un problème, du moment que toutes celles qui le deviennent en ont subies. L’extension d’un facteur de maladie peut bien être plus grande que celle de son effet, mais elle ne doit pas être plus petite. Tous ceux qui touchent ou qui s’approchent de quelqu’un qui a la variole ne contractent pas la maladie, et c’est pourtant, à peu de choses près, le seul mode de contamination connu.
Bien sûr, si l’activité sexuelle infantile était quasi générale, montrer qu’il s’en trouve dans tous les cas d’hystérie n’aurait aucun poids. Mais d’abord, c’est certainement très exagéré. Et puis la valeur explicative des scènes infantiles ne repose pas uniquement sur leur présence invariable dans l’anamnèse des hystériques, mais surtout sur la mise en évidence des liens associatifs et logiques entre ces scènes et les symptômes hystériques. C’est limpide quand on connaît toute l’histoire de la maladie.
Quels peuvent bien être les autres facteurs dont a encore besoin la « cause spécifique » de l’hystérie pour produire effectivement la névrose ? À vrai dire, Messieurs, c’est un sujet en soi, et je n’ai pas l’intention de le traiter ici. Il me suffit pour aujourd’hui d’indiquer comment s’articulent les deux volets de la question, la cause spécifique de l’hystérie et sa cause auxiliaire. Bon nombre de facteurs doivent être pris en compte : la constitution héréditaire et personnelle, la gravité des expériences sexuelles infantiles, et surtout leur accumulation (une relation brève et sans lendemain avec un garçon anonyme aura moins de conséquences que des rapports sexuels et intimes prolongés avec son propre frère). Dans la formation des névroses, les conditions quantitatives sont tout aussi importantes que les conditions qualitatives : il y a des seuils à dépasser avant que la maladie ne se déclare. Du reste, je considère que cette liste est incomplète, et qu’elle ne résout pas l’énigme de la faible incidence de l’hystérie dans les classes populaires. (Souvenez-vous d’ailleurs que, d’après Charcot, l’hystérie masculine est étonnamment répandue chez les ouvriers.)
Mais je peux aussi vous rappeler qu’il n’y a pas si longtemps [13], j’ai moi-même attiré l’attention sur un facteur négligé, que je tiens pour le principal déclencheur de l’hystérie après la puberté. J’avançais l’idée qu’on peut quasiment toujours rapporter l’apparition de l’hystérie à un conflit psychique, quand une pensée incompatible avec le moi provoque un mouvement de défense et doit être réprimée. Dans quelles conditions cet effort défensif a-t-il pour effet pathologique de repousser pour de bon dans l’inconscient le souvenir pénible pour le moi et de produire à sa place un symptôme hystérique ? Je n’aurais su le dire alors. Je complète aujourd’hui : la défense atteint son but, parvient à repousser une pensée incompatible hors de la conscience s’il existe des scènes sexuelles infantiles sous forme de souvenirs inconscients, et si la pensée qu’il faut réprimer peut entrer dans un rapport logique ou associatif avec elles. Et, dans la mesure où l’effort défensif du moi dépend de toute l’éducation morale et intellectuelle, on comprend mieux maintenant que l’hystérie soit beaucoup plus rare dans les classes populaires que ne l’y autoriserait sa cause spécifique.
Messieurs, reprenons encore une fois le dernier groupe d’objections, qui nous a conduits si loin. On a vu, et admis, que de nombreuses personnes se souviennent très clairement d’expériences sexuelles infantiles sans pour autant souffrir d’hystérie. Cette objection n’a absolument aucun poids, mais elle nous donne l’occasion de faire une précieuse remarque. D’après ce qu’on a dit de la névrose, ces gens-là ne peuvent pas être hystériques, du moins pas à cause des scènes dont ils ont un souvenir conscient. Chez nos malades, ces souvenirs ne sont jamais conscients, et c’est justement en amenant leurs souvenirs à la conscience qu’on les guérit de leur hystérie ; quant au fait qu’ils aient eu ces expériences, il n’est ni possible ni besoin d’y faire quelque chose. Comme vous le voyez, ce qui importe, ce n’est pas seulement qu’il y ait des expériences sexuelles infantiles. Une condition psychologique s’y ajoute : ces scènes doivent exister en tant que souvenirs inconscients ; elles ne peuvent produire et entretenir des symptômes hystériques que tant qu’elles sont inconscientes et dans la mesure où elles sont inconscientes. Mais qu’est-ce qui explique que ces expériences donnent tantôt des souvenirs conscients, tantôt des souvenirs inconscients ? Leur contenu, le moment où elles ont lieu, des influences ultérieures ? C’est là un nouveau problème, que je vais prudemment laisser de côté. Laissez-moi simplement vous rappeler la formule suivante, premier résultat de l’analyse : les symptômes hystériques naissent de souvenirs inconscients.
c) Je dis que les expériences sexuelles infantiles sont au fondement de l’hystérie, que, pour ainsi dire, elles disposent à l’hystérie, mais qu’elles ne provoquent pas tout de suite les symptômes hystériques ; qu’au contraire, elles restent d’abord sans effet et ne deviennent pathogènes que plus tard, quand elles sont ravivées à la puberté sous forme de souvenirs inconscients. Que faire alors des nombreuses observations montrant que l’hystérie peut apparaître dès l’enfance, avant la puberté ?
Cette difficulté s’évanouit quand on se penche de plus près sur la chronologie des expériences sexuelles infantiles dans les données d’analyse. On s’aperçoit que, dans les cas graves, la formation de symptômes hystériques commence à huit ans (c’est la règle plutôt que l’exception), et que les expériences sexuelles qui n’ont pas d’effet immédiat sont toujours plus anciennes, remontant à trois ou quatre ans, voire même à deux ans. Puisque dans tous les cas, les expériences sexuelles continuent après huit ans, il me faut admettre que ce moment – disons, quand poussent les dents définitives – constitue une limite, après quoi l’hystérie n’est plus possible : quelqu’un qui n’a pas eu d’expérience sexuelle jusque-là ne sera jamais hystérique ; il est sinon déjà susceptible d’en développer des symptômes. L’existence de cette limite étant très certainement liée au développement de l’appareil sexuel, les cas ponctuels d’hystérie avant huit ans peuvent quant à eux s’expliquer par une maturité précoce. Il s’agit là d’un phénomène fréquent, et on peut penser d’ailleurs qu’une stimulation sexuelle prématurée y contribue.
C’est l’indice qu’un certain état infantile des fonctions psychiques comme de l’appareil sexuel est requis pour qu’une expérience sexuelle durant cette période produise plus tard, sous forme de souvenir, un effet pathogène. Je ne me risquerai pas pour le moment à des considérations plus précises sur la nature de cette immaturité psychique ou sur ses limites dans le temps.
d) On s’offusquera peut-être encore de ce que le souvenir des expériences sexuelles infantiles puisse avoir un effet pathogène aussi prodigieux alors qu’elles n’en ont pas eu par elles-mêmes. Et en effet, on n’a pas l’habitude de voir sortir d’un souvenir des forces qui étaient absentes de l’impression réelle. Vous remarquerez d’ailleurs avec quelle constance l’hystérie vérifie ce principe que ses symptômes ne peuvent naître que de souvenirs. Les scènes récentes, qui voient l’apparition des symptômes, ne sont pas les scènes opérantes, et les expériences qui sont opérantes n’ont d’abord aucun effet. On peut toutefois à bon droit dissocier ce problème de notre sujet.
Mais récapitulons – le besoin s’en fait sentir, tant sont frappantes, en y repensant, les conditions qu’on a pu découvrir : que, pour former un symptôme hystérique, il doit y avoir un effort défensif contre une pensée pénible ; que celle-ci doit présenter un lien logique ou associatif avec un souvenir inconscient, moyennant un certain nombre de maillons intermédiaires, inconscients eux aussi ; que ce souvenir inconscient ne peut avoir qu’un contenu sexuel ; que ce contenu est une expérience infantile. Et donc, on ne peut s’empêcher de se demander comment ce souvenir d’une expérience d’abord sans conséquence peut bien avoir après-coup pour effet, anormal, de conduire un processus psychique comme la défense à un résultat pathologique – tout en restant lui-même inconscient.
Soyons sûrs néanmoins que c’est là un problème purement psychologique, dont la solution requiert peut-être des hypothèses particulières sur les processus psychiques normaux et sur le rôle qu’y joue la conscience mais qui, en attendant, peut rester en suspens sans que nos conclusions sur les causes des phénomènes hystériques en soient affectées.
3e partie
Messieurs, le problème que je viens d’esquisser concerne le mécanisme de la formation des symptômes hystériques. Mais je dois parler de ce qui cause les symptômes sans en tenir compte, et on y perd inévitablement en finesse et en clarté.
Revenons au rôle des scènes sexuelles infantiles. Je crains qu’à cause de moi vous ne surestimiez leur pouvoir de former des symptômes. C’est pourquoi j’insiste encore une fois : tous les cas d’hystérie présentent des symptômes qui ne sont pas déterminés par des expériences de l’enfance mais par des expériences plus tardives, et souvent récentes. D’autres symptômes – les doyens, pour ainsi dire – remontent par contre aux toutes premières expériences. Il s’agit en particulier des sensations et des troubles sensoriels si nombreux et si différents affectant les organes génitaux et d’autres parties du corps, qui correspondent tout simplement au contenu sensible des scènes infantiles, reproduit sur un mode hallucinatoire et, souvent, douloureusement exacerbé.
Un autre groupe de phénomènes hystériques on ne peut plus communs (besoin douloureux d’uriner, sensations particulières lors de la défécation, troubles intestinaux, nausée et vomissement, maux d’estomac et dégoût pour la nourriture) s’avère aussi à l’analyse – et avec quelle régularité ! – dérivé des mêmes expériences infantiles, et s’explique facilement par certaines caractéristiques constantes de ces expériences. Pour qui a une sexualité normale, les scènes sexuelles infantiles sont proprement insupportables. On y trouve tous les abus connus des débauchés et des impuissants, avec le détournement de la bouche et de l’anus à des fins sexuelles [14]. Mais chez le médecin, la lucidité prend vite le pas sur la stupéfaction : on ne peut attendre de quelqu’un qui n’a aucun scrupule à assouvir ses besoins sexuels sur des enfants qu’il s’embarrasse de nuances dans sa façon de le faire ; et l’impuissance sexuelle inhérente à l’enfance pousse inévitablement aux mêmes pratiques de substitution que l’impuissance acquise chez l’adulte.
Ce couple inégal mène sa relation amoureuse dans d’étranges conditions. L’adulte, pas plus que l’enfant, ne peut échapper à la dépendance mutuelle qu’entraîne nécessairement une relation sexuelle, mais il est armé d’une autorité absolue et du droit de punir, et peut échanger les rôles pour la satisfaction sans limite de ses caprices. Démuni, à la merci de cet arbitraire, l’enfant est quant à lui prématurément éveillé à toutes sortes de sensations, exposé à toutes les déconvenues, et souvent interrompu, dans ce qui est exigé de lui, par la maîtrise imparfaite de ses besoins naturels. Toutes ces aberrations, grotesques mais tragiques, imprègnent le développement futur de l’individu et de sa névrose de mille et une façons, qui mériteraient d’être suivies dans les moindres détails. Les scènes sexuelles ne sont pas moins abjectes dans les relations entre enfants, puisqu’elles supposent que l’un d’eux a d’abord été séduit par un adulte : les conséquences psychiques en sont extraordinairement profondes ; une chaîne invisible les attache l’un à l’autre pour le restant de leurs jours.
Ce sont parfois les circonstances particulières de ces scènes sexuelles infantiles qui déterminent plus tard les symptômes de la névrose. Dans un de mes cas par exemple, le fait d’avoir été dressé, enfant, à stimuler les organes génitaux d’un adulte avec son pied, a suffi pour provoquer pendant des années une fixation névrotique sur les jambes et leur fonction et, finalement, une paraplégie hystérique. De même, pourquoi une malade s’accrochait-elle à l’une en particulier de ses nombreuses sœurs pour calmer les crises d’angoisse qui la prenaient à certaines heures de la journée ? Un mystère, si l’analyse n’avait montré qu’à l’époque, l’agresseur se renseignait à chacune de ses visites sur la présence de cette sœur, craignant sans doute qu’elle ne le dérange.
Il arrive que le pouvoir de détermination des scènes infantiles soit si bien caché qu’une analyse superficielle passera forcément à côté. On s’imagine avoir trouvé l’explication d’un symptôme donné dans le contenu d’une scène récente, avant de tomber sur le même contenu dans une scène de l’enfance – et alors on est bien obligé d’admettre que la plus récente des deux scènes ne doit en fait sa force qu’à sa concordance avec la plus ancienne. Pour autant, je ne veux pas faire comme si elle n’avait pas d’importance. Si j’avais à vous parler des règles de formation des symptômes hystériques, celle-ci en ferait partie : est choisie pour faire symptôme une idée que plusieurs facteurs désignent ensemble, qui est éveillée de plusieurs façons à la fois – ce que j’ai essayé d’exprimer ailleurs en disant que les symptômes hystériques sont surdéterminés [15].
Autre chose, Messieurs. Tout à l’heure, j’ai laissé de côté le rapport entre les causes récentes et les causes infantiles de l’hystérie, car c’est une question à part. Mais malgré tout, je ne peux pas en rester là sans faire au moins une remarque. Reconnaissez que c’est surtout une chose qui nous déconcerte dans les phénomènes hystériques, et qui semble nous dissuader de loger à la même enseigne les actes psychiques des hystériques et des personnes normales. Je veux parler de la disproportion entre stimulus et réaction psychiques, dont on cherche à rendre compte en supposant une sensibilité globalement anormale, et qu’on s’efforce souvent d’expliquer par la physiologie : comme si les parties du cerveau qui servent à la transmission des informations se trouvaient chez ces malades dans un état chimique particulier (un peu comme la moelle épinière d’une grenouille sous strychnine [16]) ou comme si elles échappaient à l’influence des centres inhibiteurs supérieurs (comme dans les expériences de vivisection animale).
De temps en temps, oui, l’une ou l’autre de ces théories peut tout à fait expliquer les phénomènes hystériques. Mais pour l’essentiel, la réaction hystérique, anormale, exagérée, aux stimuli psychiques admet une autre explication, soutenue par quantité d’exemples tirés des analyses. Et cette explication, la voici : la réaction des hystériques n’est exagérée qu’en apparence ; si elle semble exagérée, c’est parce qu’on ne connaît qu’une petite partie de ses motifs. En réalité, elle est proportionnelle au stimulus : elle est donc normale, et se comprend très bien du point de vue psychologique. On le voit tout de suite quand on ajoute aux motifs manifestes et conscients ceux que le malade ignore, et dont il n’a donc pas pu nous parler.
Je pourrais passer des heures à démontrer cette importante proposition pour l’activité psychique hystérique dans son ensemble, mais je dois me contenter ici de quelques exemples. Vous vous souvenez de l’« émotivité » si fréquente des hystériques qui, au moindre indice de mépris, réagissent comme s’ils avaient été mortellement offensés. Que diriez-vous maintenant d’un tel degré de susceptibilité chez deux personnes en bonne santé, un couple par exemple ? Certainement que la dernière broutille n’explique pas à elle seule la scène de ménage que vous avez vue, mais qu’elle a mis le feu à la montagne de griefs qui s’accumulaient depuis longtemps.
Et maintenant, appliquons ce raisonnement aux hystériques. Ce n’est pas la dernière offense, minime, qui provoque la crise de larmes, l’accès de désespoir ou la tentative de suicide, au mépris du principe qu’un effet doit être proportionnel à sa cause. En fait, cette petite offense a réveillé et activé le souvenir d’offenses antérieures, bien plus nombreuses et plus vives, derrière lesquelles se cache encore le souvenir d’une grave offense durant l’enfance qui n’a jamais été surmontée. Ou encore : devant l’énigme d’une jeune fille qui se fait les reproches les plus effroyables, au point d’en tomber malade, parce qu’elle a supporté qu’un garçon lui caresse tendrement la main en secret, vous pouvez bien sûr faire d’elle quelqu’un d’anormal, excentrique et hypersensible. Mais vous changerez d’avis en apprenant par l’analyse que cette caresse-là lui a rappelé une caresse semblable dans une scène moins anodine de sa petite enfance, de sorte que les reproches qu’elle s’adresse valent en fait pour cette fois-là.
En fin de compte, l’énigme des points hystérogènes [17] est du même ordre. En touchant un endroit bien particulier du corps, vous réveillez par mégarde un souvenir susceptible de provoquer une crise de convulsion et, puisque vous ignorez tout de ce maillon psychique intermédiaire, vous prenez cette crise pour un effet direct de votre geste. Les malades sont dans la même ignorance et font donc les mêmes erreurs. Ils font sans cesse des « fausses connexions » [18] entre la dernière circonstance dont ils ont conscience et l’effet, qui dépend de tant de maillons intermédiaires. Mais qu’un médecin, pour expliquer une réaction hystérique, soit en mesure de rassembler les motifs conscients et les motifs inconscients, et il est presque toujours obligé de reconnaître que cette réaction apparemment excessive est en fait appropriée, que seule sa forme est anormale.
Vous me répondrez alors, et à juste titre, que la réaction hystérique telle que je la justifie n’est quand même pas normale. Pourquoi sinon les gens en bonne santé se comportent-ils différemment ? Pourquoi, chez eux, les nouvelles excitations ne ravivent-elles pas les plus anciennes ? On a effectivement l’impression que chez les hystériques, toutes les expériences du passé (auxquelles ils ont déjà réagi si souvent, et violemment qui plus est) conservent leur force, comme s’ils étaient incapables de liquider les stimuli psychiques. Tout juste, Messieurs : il faut bien admettre quelque chose de ce genre. N’oubliez pas que c’est sous forme de souvenirs inconscients que les expériences passées des hystériques s’expriment dans des circonstances présentes. Il semble que la difficulté à liquider une impression donnée, l’impossibilité d’en faire un souvenir comme un autre tiennent précisément à la nature de l’inconscient psychique. Vous voyez que ce qui reste à expliquer relève une fois encore de la psychologie, et d’une sorte de psychologie que les philosophes n’ont pas beaucoup défrichée.
C’est aussi à cette psychologie – une psychologie à notre usage, qui reste à faire : la future psychologie des névroses – que je dois vous renvoyer en annonçant pour finir quelque chose qui risque d’abord de bousculer notre compréhension naissante des causes de l’hystérie. Car je dois dire que le rôle des expériences sexuelles infantiles ne se limite pas à l’hystérie, mais vaut de la même manière pour la curieuse névrose obsessionnelle, et peut-être même encore pour les différentes formes de paranoïa chronique et pour d’autres psychoses fonctionnelles [19]. Je suis plus prudent ici, parce que j’ai analysé pour l’instant beaucoup moins de névroses obsessionnelles que d’hystéries et que je ne dispose pour la paranoïa que d’une seule analyse convenable et de quelques analyses fragmentaires. Mais ce que j’y ai trouvé m’a paru solide et me rend confiant pour la suite. Vous vous en souvenez peut-être, j’ai déjà recommandé que l’hystérie et les obsessions soient rassemblées sous le terme de « névroses de défense » [20], avant même de connaître leur origine infantile commune. Je dois maintenant ajouter – sans présumer qu’il en va toujours ainsi – que mes cas d’obsessions ont tous laissé voir un fond de symptômes hystériques, des sensations et des douleurs en général, qui renvoyaient justement aux toutes premières expériences de l’enfance. Les scènes inconscientes donnent donc plus tard, une fois associées aux autres facteurs pathogènes, une hystérie, une névrose obsessionnelle, ou même une paranoïa : mais dans ce cas, qu’est-ce qui en décide ? Ici, les progrès de l’analyse semblent bien nuire à la valeur explicative de ces scènes, puisqu’on y perd la spécificité de leur relation à l’hystérie.
Messieurs, je ne suis pas encore en mesure de donner une réponse fiable à cette question – mes cas ne sont ni assez nombreux ni assez variés pour cela. Ce que je constate jusque-là, c’est qu’à l’analyse, il faut souvent voir sous les obsessions des reproches contre soi-même déguisés et transformés relatifs à des agressions sexuelles dans l’enfance : c’est pourquoi elles se rencontrent plus souvent chez les hommes que chez les femmes, et se développent chez eux plus souvent que l’hystérie. Je pourrais en conclure que la nature des scènes infantiles (y avait-il du plaisir ou seulement de la passivité ?) a des conséquences décisives sur le choix de la névrose ultérieure, mais je ne voudrais pas sous-estimer non plus l’influence de l’âge ou d’autres facteurs. Sur tout cela, attendons de voir ce que les prochaines analyses auront à nous dire. Mais quand on saura clairement quels facteurs tranchent entre les différentes formes de psychonévroses de défense, en établir le mécanisme sera encore une fois un problème purement psychologique.
Me voilà au bout de ce que j’avais à dire aujourd’hui. Une dernière chose – car je sais votre opposition et votre incrédulité : quoi que vous pensiez de mes résultats, je vous demanderai de ne pas y voir le fruit de spéculations de bas étage. Ils reposent sur des études de cas laborieuses, qui ont demandé pour la plupart une centaine d’heures de travail, minimum. Mais ce qui m’importe surtout, c’est l’attention que vous porterez au procédé dont je me suis servi, inspiré de Breuer ; un procédé nouveau, difficile à manier, et pourtant irremplaçable sur le plan scientifique comme sur le plan thérapeutique. Vous voyez bien qu’on ne peut pas décemment contester ses résultats sans s’intéresser à la méthode elle-même, en se servant uniquement de l’examen traditionnel des malades – autant chercher à réfuter les découvertes de la technique histologique à l’aide de l’enquête macroscopique [21]. En donnant largement accès à un nouvel élément de l’activité psychique (les processus de pensée inconscients ou, selon l’expression de Breuer, « incapables de conscience » [22]), cette nouvelle méthode d’investigation fait naître l’espoir de mieux comprendre tous les troubles psychiques fonctionnels. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que la psychiatrie se passe encore longtemps de ce nouveau chemin vers la connaissance.
notes
[1] La notion d’hystérie a fait l’objet de tant d’interprétations et de contestations qu’il est difficile d’en donner une définition précise en peu de mots. Disons simplement que ce dont Freud cherche à rendre compte ici, c’est d’un ensemble de symptômes corporels variés (hypersensibilité de certaines parties du corps, troubles sensoriels divers, douleurs, paralysies partielles, etc.), généralement accompagnés d’une forte charge émotionnelle (dégoût, angoisse, etc.), et énigmatiques, puisqu’aucune anomalie organique (une lésion, par exemple) ne permet de les expliquer.
[2] Freud ne fait pas de l’hystérie une pathologie exclusivement féminine. Comme il l’indique plus loin, il compte parmi ses patients un tiers d’hommes.
[3] Jean-Martin Charcot (1825-1893), médecin français célèbre pour ses « présentations de malades » hystériques à l’hôpital de la Salpêtrière.
[4] La syphilis est une maladie sexuellement transmissible – d’où les « protestations du patient » quant à « l’existence d’une source d’infection ».
[5] Josef Breuer (1842-1925), médecin viennois intime de Freud, cosigne avec lui les Études sur l’hystérie, publiées en 1895. Il y expose notamment le cas d’Anna O. et de sa « cure par la parole », soit la remémoration et le récit cathartique, sous hypnose, des événements à l’origine de ses symptômes.
[6] Charcot désigne par le terme de « stigmates » les caractères permanents de l’hystérie (anesthésies localisées, troubles des sens, etc.), par opposition à la symptomatologie des crises.
[7] Par analogie avec les états psychiques que produit l’hypnose – par exemple, quand une « rêverie éveillée » est saisie par une émotion forte.
[8] Note de Freud : « Je laisse volontairement de côté la question du type d’association qui les relie (simultanéité, relation causale, similarité de contenu, etc.) et celle de leur nature psychologique respective (consciente ou inconsciente). »
[9] Sur Anna O., voir la note 5.
[10] Le XIXe siècle a vu se succéder plusieurs expéditions européennes à la recherche des sources du Nil, un fleuve qui fascinait déjà l’antiquité grecque et romaine.
[11] Voir la note 1. Si on n’est pas en mesure de mettre en évidence les anomalies organiques au principe des symptômes hystériques, c’est peut-être, dit-on, parce que ces « modifications anatomiques » sont si ténues qu’elles nous ont échappé jusque-là.
[12] Le terme de « séduction » (comme, plus loin, celui de « relation amoureuse ») n’est pas dépourvu d’ambiguïté, puisqu’il peut suggérer une participation librement consentie de l’enfant. L’usage qu’en fait Freud renvoie toutefois très clairement à des situations d’agression.
[13] Dans un article de 1894 sur « Les psychonévroses de défense ».
[14] Ici comme en d’autres endroits du texte, le propos de Freud est évidemment très rétrograde.
[15] Dans les Études sur l’hystérie, au chapitre « Psychothérapie de l’hystérie ».
[16] La strychnine est un poison violent. À faible dose, elle a des effets stimulants sur le système nerveux.
[17] Charcot décrit sous le nom de « zones hystérogènes » des parties du corps investies d’une sensibilité anormale et dont la stimulation provoque un accès hystérique.
[18] L’expression apparaît plusieurs fois dans les textes de Freud à cette époque, par exemple dans l’article de 1894 sur « Les psychonévroses de défense ». Elle désigne d’ordinaire un mécanisme psychologique et non une simple erreur d’interprétation.
[19] Voir la note 1. On dit d’un trouble qu’il est « fonctionnel » quand il n’a pas d’origine organique identifiée.
[20] Dans l’article de 1894 sur « Les psychonévroses de défense ». Sur la notion de « défense », voir plus haut.
[21] L’histologie est l’étude microscopique des tissus biologiques.
[22] Dans les Études sur l’hystérie, au chapitre « Considérations théoriques ».
crédits
isbn (lyber) 979-10-92903-09-6
© Dans nos histoires, 2021 pour la traduction